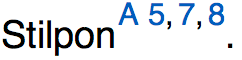Pourquoi est-ce que je m'amuse à lancer un blog à propos de Wikipédia ? Je n'en sais strictement rien […] Très insidieusement, l'encyclopédie en ligne m'a amené à m'impliquer sans cesse plus avant […] Ça y est. C'est foutu. Je ne pourrais plus imaginer un monde sans Wikipédia. Il ne me reste plus qu'à rendre compte du monde avec Wikipédia. Cet avec sera l'objet de ce blog.Ainsi, je n’aurais pas pas choisi Wikitrekk. J'aurais simplement franchi une nouvelle étape d’un processus d’implication toujours croissant. En démontre d’ailleurs le fait que, lorsque le besoin s’est fait sentir, Wikitrekk a fait des petits : Hotel Wikipedia, dans une optique plus généraliste et Internationalwikitrekk, dans une optique plus internationalisée…
Il est toujours difficile d’évaluer ses propres créations. Wikitrekk est-il bon ou médiocre, nécessaire ou subsidiaire, je dois dire que je n’en sais rien. Par contre, il m’est possible de juger son adéquation à sa conception originelle. Wikitrekk a-t-il accompli toutes ses promesses ?
Je m’étais fixé initialement deux missions distinctes.
La première a été assez rapidement délaissée. Il s’agissait de produire une sorte des « analyses créatrices » de divers articles de Wikipédia. Je m’efforçais de réaliser un Wikigrill alternatif, qui ne viserait pas à démonter un article, mais à le corriger. A ce jour, l’exercice n’a été pleinement réalisé qu’une seule fois, à propos de la Politique étrangère du Vatican. J’y reviendrai peut-être (pour ceux qui aiment le pointu grave, je songe à faire quelque chose sur les amphibiens et les proto-reptiles du carbonifère supérieur…).
Ma seconde mission s’est avérée plus heureuse : suivre, publiciser et, éventuellement, provoquer les débats sur le fonctionnement de l’encyclopédie. Ce faisant, je me suis un peu comporté en reporter wikipédien, se transportant éventuellement sur des terrains étrangers (surtout en pays germanophone ou italophone). Je me suis ainsi retrouvé face à un lectorat d’une diversité insoupçonnée : des allemands, des italiens, mais aussi des chinois, des finlandais, des brésiliens…
 |
| Cartographie du lectorat de Wikitrekk |
C’est que Wikipédia tend à devenir un sujet de société au sens large. Ce statut lui donne des responsabilité nouvelles : l’encyclopédie en vient presque à assurer un service public de la connaissance avec toutes les conséquences que cela suppose en terme d’accessibilité et d’accueil des nouveau. Cela lui confère également un pouvoir, comme le démontre l’efficacité (mais aussi, peut-être, la nocivité) des blackouts de protestations — le dernier en date est d’ailleurs tout récent.
Ceci m’amène à proposer une sélection de douze billet, comme les douze mois de l’année — à ceci près que l’appariement d’un mois et d’un billet n’est pas véritablement respecté. Pour diverses raisons, novembre, avril et mai sont absents du lots, ce qui profite in fine à août, janvier et juin.
Juillet : Easy come, uneasy go. Le Billet qui m’a lancé, en partie grâce à une recension du Choix du Chaos. Le hasard voulait que je commence mon blog, au moment où Alithia fermait le sien. L’analyse se doublait ici d’une sorte de correspondance symbolique.
Août (1) : Par voie référendaire. La Wikimedia Foundation organisait une vaste consultation autour de l’implantation prochaine d’un filtre d’image, soit d’une fonctionnalité permettant de masquer les images jugées choquantes par un utilisateur. Le point qui me dérageait le plus ici était d’ordre procédural : le référendum ne mettait jamais en question l’Image Filter dans son principe-même, mais discutait uniquement de ses modalités. Suivant l’exemple de nos cousins germains, j’ai fini par lancer un sondage local sur la wikipédia francophone. On a peu entendu parler du filtre depuis — ce qui me laisse à penser qu’il se trouve vraisemblablement en development hell.
Août (2) : Deux poids, une mesure. Dans un papier paru dans le Monde des livres, Pierre Assouline prend la défense d’un plagiaire notoire, Joseph Macé-Scaron. Il en profite pour dénoncer le rôle de gendarme de Wikipédia — l’article sur Macé-Scaron a très vite rapporté ses faits et méfaits. Une posture plutôt paradoxale, si l’on songe que quelques années plus tôt, il critiquait l’encyclopédie pour sa propension à encourager le plagiat estudiantin…
Septembre : Les Wikipédias sans Comité d'arbitrage : le cas italien. En plein débat sur le fonctionnement du Comité d’arbitrage (qui se poursuit d’ailleurs encore aujourd’hui), je tentais une incursion sur une Wikipédia qui fonctionne sans recourir à ce mode de résolution des conflits. L’intérêt de ce billet, c’est surtout que j’ai commencé à me familiariser à l’organisation de la WIkipédia italienne, juste avant qu’elle ne se retrouve sous les feux de l’actualité…
Octobre : La fin temporaire de la Wikipédia italienne. Pendant plusieurs jours, le blackout de la Wikipédia italienne a largement occupé mon esprit. Cet intérêt s’est prolongé par-delà ce blog. J’ai ainsi rédigé la traduction officielle du manifeste des utilisateurs italiens. Tout récemment je signalais que de nouvelles discussions étaient en cours à propos d’un nouveau blackout — la situation s’étant temporairement éclaircie, ça n’a finalement rien donné.
Décembre : La Wikipédia anglophone en grève La série des blackouts se poursuit et touche désormais la Wikipédia anglophone. A ce stade la grève n’était pas encore acté, mais si le processus d’acceptation était en bonne voie. Pour la suite de l’histoire, on peut se référer à un autre billet, publié sur Rue89.
Janvier (1) : Le tournant. J’aime bien ce billet, paru en début d’année, qui vise à dresser une sorte bilan prospectif de l’encyclopédie. Le point essentiel qui en ressort, c’est la nécessité d’améliorer l’accessibilité de l’interface encyclopédique et d’encourager les contributions ponctuelles. On devrait ainsi passer d’une relation contributeur / lecteur à une relation contributeur actif / contributeur potentiel.
Janvier (2) : Wikibétisation partielle. Dans la lignée du billet précédent, je préconisais de dégager une sorte de digest (c’est-à-dire les règles et modèles essentiels à connaître pour pouvoir commencer à contribuer sans se faire jeter). Le gros travail mené par le projet Accueil des nouveaux a permis d’avancer considérablement sur ce terrain.
Février : Universitaires sans critères. Je proposais ici de créer un namespace Auteur:, destiné à accueillir des informations fondamentales sur les universitaires et chercheurs, qui ne seraient pas admissibles sur l’espace encyclopédique. Les sources produites par ces derniers sont en effet préférentiellement utilisées pour référencer le contenu encyclopédique. De cette petite réflexion, j’ai tiré une proposition plus large… qui n’a finalement pas donné grand chose. La mise en place de Wikidata condamne pour l’heure cette initiative à un certain development hell.
Mars : Esprit critique. Il s’agit d’une réaction à l’expérience menée par le professeur Loys Bonot, qui a intentionnellement vandalisé une page wikipédia pour tromper ses élèves. Je me suis aperçu entre-temps que celiui-ci m’a répondu sur son blog. Enfin, répondre est un bien grand mot. Disons plutôt qu’il a « corrigé ma copie » en soulignant dûment en rouge les passages jugés hors sujet ou irrecevable. Si c’est ça l’esprit critique qu’il promeut, je ne suis pas certain que ça soit indispensable…
Juin (1) : Autocitation. La problématique de l’autocitation (le fait de citer ses propres travaux universitaires dans le cadre d’un article de wikipédia) paraît assez limitée aujourd’hui. Elle risque peut-être de prendre de l’ampleur par la suite en raison de l’intrication croissante entre l’encyclopédie et le monde universitaire. On va peut-être voir émerger une classe de super-contributeur, capable d’agir non seulement de reporter, mais aussi de créer, indirectement, le contenu encyclopédique…
Juin (2) : Où en est Wikidata ? Je clos donc la série sur Wikidata. Je m’intéresse ici aux procédés élémentaires de la grammaire wikidatienne et à ses potentialités en terme de rédaction encyclopédique. C’est ainsi que l’on s’achemine doucement sur le territoire de la science fiction. Ce qui confère d’ailleurs à mon wiki-roman-feuilleton de l’été dernier une certaine portée prédictive. Je prévoyais ni plus ni moins que l'essentiel des contributions seraient le fait de super-bots :
Les bots représentaient désormais près de 99,5% des contributions. Mis au point en 2036, le programme SC, ou synthèse-conversant remplaçait adéquatement la plupart des interventions humaines. Les bots pouvaient synthétiser n’importe quel texte de référence. Ils étaient capables de justifier leur modifications et d’en discuter avec n’importe quel intervenant humain.